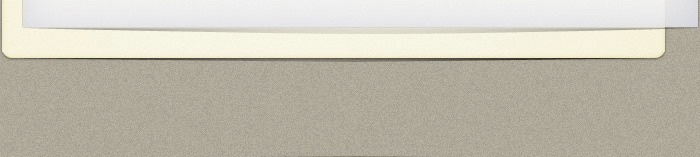Artension, n° 30; Juillet-Aout 2006
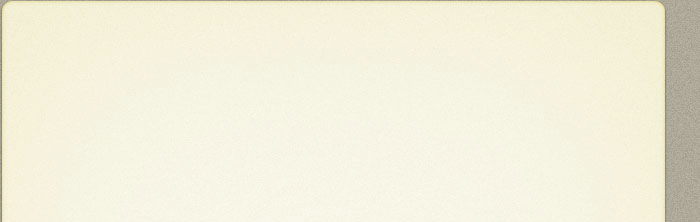
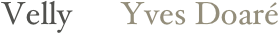

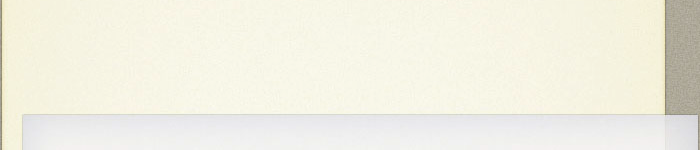
A propos de l’ “art visionnaire”
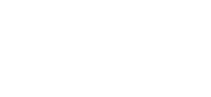

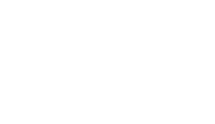


ARTENSION 2006
A propos de l’« Art Visionnaire »
par Yves Doaré
À une époque où les hommes cherchent par tous les moyens à combler un vide spirituel, ce que l’on présente comme « art visionnaire» reste cependant dangereusement menacé d’amalgames et trop souvent encombre d’irrationnel. Les querelles esthétiques laissent indifférents ces créateurs, car ils se préoccupent peu d’histoire de l’art. Cette réserve leur donne d’ailleurs plus de liberté pour traiter de questions intemporelles, ce qu’ils affectionnent particulièrement. Ils sont à l’aise pour dénoncer la vanité des choses humaines devant les forces naturelles.
Y.D.
À la fin de la Renaissance, quelque chose s’est rompu entre l’homme et la nature. Celle-ci est devenue instable à nos yeux, et l’homme, plus tourmenté. L’histoire de l’art nous apprend qu’après ce changement, les peintres baroques et maniéristes ont souvent traité de sujets à caractère fantastique ou visionnaire comme la hantise de la mort, la métamorphose infinie, le merveilleux, l’ambigu, l’objet ruiné. Mais au-delà des classifications de l’histoire de l’art, on peut dire que toute peinture est visionnaire dans la mesure où elle est transposition d’une réalité ou affirmation d’un imaginaire. C’est parce que le peintre s’abandonne à une vision que s’organise lentement devant lui la substance d’un tableau. À l’issue d’une succession de «catastrophes», de «grâces» et d’«événements», cette vision est peu à peu devenue un «bloc de sensation » (1), qui est l’apparition d’une figure radicalement nouvelle. Cette figure, il la reconnaît tant il l’a espérée. C’est un lieu de « ressemblance» ou de réminiscence qui a désormais le pouvoir de convoquer et d’entretenir le désir.
Quand l’artiste ne se reconnaît plus dans une communauté visuelle
Depuis toujours des peintres interrogent et transforment notre prison terrestre pour la jouissance de notre regard. Depuis toujours des voyants s’en échappent et nous en délivrent par un art du sublime, du monstrueux ou du surnaturel. Parmi eux, Jérôme Bosch, Hercules Seghers, William Blake. Turner, Bresdin, Gustave Moreau, Odilon Redon. La peinture du XXè siècle a été marquée par une libération joyeusement iconoclaste qu’on a pu voir se réduire parfois en consensus ennuyeux. Nous baignons aujourd’hui dans une exaltation de la créativité, et le monde visuel est envahi d’images; il y a fatigue et surenchère. Beaucoup d’artistes n’ont pas suivi les mouvements ou les directives de l’«art contemporain», et parmi ces réfractaires on trouve aujourd’hui des héritiers des grands peintres fantastiques et des grands visionnaires du passé évoqués plus haut.
Quand l’artiste ne se reconnaît plus dans une communauté visuelle, il se retire en lui-même et s’interroge sur le cœur de l’homme. Il s’ouvre aux archaïsmes, aux chamanismes, aux visions. Le peintre fait de sa pointure un enfermement, une errance, un travail «aux limites» où tout peut vaciller. Il y invente des mondes merveilleux ou oppressants; l’œuvre devient pour lui un lieu de méditation sur le chaos, ou encore un outil de connaissance à la manière alchimiste. À propos de ces peintres et de ces graveurs marginaux, certains auteurs ont parlé d’ «art visionnaire». Mais sous cette appellation nébuleuse, on a souvent confondu des artistes à la virtuosité fascinante mais gratuite avec d’authentiques inspirés, naïfs ou savants. On a fait abusivement voisiner ceux qui se perdent dans une représentation maniaque de insolite (ou bien s’épuisent à fabriquer un «fantastique pépère» qui voudrait nous faire croire à un nouvel ésotérisme) avec les plus éclairés, dont la vision s’impose comme une ouverture rédemptrice. Parmi ces derniers, qui sont des veilleurs solitaires (dont beaucoup sont restés fidèles au modèle classiques de la représentation), quelques uns parviennent à retrouver l’innocence et à s’affranchir du temps et de l’histoire. C’est alors un miracle, une révélation, un accord profond à nouveau réalisé qu’ils nous font partager sur leurs toiles ou dans leurs gravures, car beaucoup d’entre eux sont aussi graveurs. Parmi ces artistes, j’en citerai trois, chez lesquels, dans les années soixante-dix, je trouvais des préoccupations voisines des miennes: Jacques Le Maréchal (2), François Lunven et Jean-Pierre Velly.
un nouveau millénarisme
André Pieyre de Mandiargues note dans un texte de 1968 la curieuse fascination» qu’exerce sur lui la grande Vue de Londres à partir de Piccadilly Circus, de Jacques Le Maréchal, « où la ville paraît une sombre Venise dressée hallucinant désordre sur des eaux de métal incandescent. » (3). Et André Breton, en 1960: «Le Maréchal est le seul qui sache que les visions sont une gaze encore, mère laquelle se tapissent d’autres gazes à visions, et ainsi de suite: d où son désespoir d’avoir à compter avec le temps humain qui arrache ses œuvres sans qu’il ait pu les finir (entendez: remonter, d’écorce en écorce, jusqu’au noyau incandescent). Ainsi en fut-il de maint grand visionnaire, tel Gustave Moreau, dont les œuvres capitales ont été abandonnées, comme on dit, en cours d’exécution, en réalité parce qu’elles frôlaient l’abîme et fleuraient l’interdit. De telles œuvres, il est de leur nature de demeurer ainsi suspendues, et ce n’est pas ce qui nous les rend moins chères. » (4)
De tels éloges de la part d’illustres écrivains nous incitent à en savoir plus sur le travail de cet artiste. En 1974, un texte d’Alain Jouffroy intitulé Le Maréchal, un nouveau millénariste, nous renseigne plus nettement sur la nature de son œuvre : « La réalité politique et la réalité cosmique entrent manifestement en collision dans un grand nombre de ses peintures, dont le titre nous éclaire déjà avec beaucoup de précision: l’Arbre mécanique s’agite à la fin du spectacle dans un paysage foudroyé par le profit; Le Monstre d’État; L’autre monde va rencontrer celui-ci; Le Sacré- Cœur de la canaille; Paysage peu à peu gagné par la technique, etc. Quand on se rappelle que Le Maréchal n’a pas attendu la mode de l’écologie et la lutte actuelle contre la croissance industrielle systématique, on découvre, en effet, ses dons de devin sinon de prophète. Pour lui, «le grand amour de la monnaie fait éclater les rêves», et l’on peut se demander si l’abandon de certaines de ses œuvres en cours d’exécution n’est pas dû, très secrètement, à une résistance obstinée, plus ou moins consciente, contre les impératifs de profit dont un peintre réputé comme lui devient aujourd’hui, dans notre «économie de marché», la victime privilégiée. Il les garde à ses murs, en attendant on ne sait quel cataclysme libérateur, qui lui permettrait de sauver ses tableaux de l’ambiguïté où les ferait tomber un trop grand succès. C’est pour ces raisons conjuguées - ces dons de «visionnaire », cette lucidité politico-économique, cette fidélité à ses propres idées, cette volonté de préserver en lui la pureté- que l’on peut relire aujourd’hui avec d’autres yeux la phrase de Bachelard selon laquelle « On ne s’étonnera pas que pour un philosophe de telles œuvres soient les germes de rêveries infinies. » (5) C’est dans un texte intitulé Le Terrain vague (6), écrit en 1957, que Gaston Bachelard avait en effet déjà pressenti en cet artiste la qualité d’un veilleur à l’écoute du monde, soucieux de révéler les forces qui maintiennent son unité et celles qui la menacent. Mais curieusement cette faillite de la science dans son incapacité à contenir de nouvelles formes de barbarie, Le Maréchal persiste à vouloir en rendre compte à l’aide du vieux modèle cosmogonique, et il affirme par là sa révolte et sa préoccupation humaniste. On comprendra que de se charger de tels sujets en peinture au XXè siècle avec de telles exigences dans le travail ait attiré des admirateurs et des disciples.
Georges Rubel: «perpétuer l’état de grâce
dans lequel me plonge
la vision dans le cuivre»
Le graveur Georges Rubel fut l’un des «élèves» de Le Maréchal, et il est intéressant de rapprocher ce qu’il écrit en 2006 sur son propre travail avec ce que l’on vient de lire sur celui de Le Maréchal: « Lorsque je me suis mis au travail, vers 1963, nous notions pas encore assaillis d’images disparates, comme aujourd’hui. Cependant, une certaine nostalgie du beau métier me fit révérer les maîtres anciens. À partir d’une exigence ingénue de bien faire, de faire comme les grands, en quelque sorte, ma pratique m’a conduit à la recherche assidue, peut-être névrotique, d’une image possible, dont la qualité particulière serait d’abolir le temps imparti aux hommes sur cette terre l’espace d’une rêverie. Cette ambition absurde et démesurée fait de moi à la fois un ancien et un moderne, laissant l’image se faire et se défaire selon l’état d’esprit du jour, sans souci d’achèvement aucun. Se succèdent diverses possibilités d’image sur un même cuivre, dont témoignent des états toujours nombreux. Sur les fonds obtenus en contre-épreuve (impression d’une épreuve fraîchement sortie de la presse sur un papier pour l’aquarelle), je brode en couleur d’autres paysages incertains, dans l’attente d’un je - ne - sais - quoi qui peut être la mort du monde, ou plutôt la fin de ma perception particulière de ce monde.» Ce texte vaut pour beaucoup de visionnaires inspirés, du passé comme du présent. Georges Rubel ne «produit» pas des œuvres. Il s’applique plutôt à retrouver et perpétuer l’état de grâce dans lequel le plonge la vision dans le cuivre.
Les «figures fantastiques» de François Lunven
Elles se sont peu à peu détachées de la représentation mimétique, inventant leur espace propre, et à l’inverse des deux graveurs que je viens d’évoquer plus haut, il n’éprouvait pas ce besoin d’abandonner son travail à la durée. Au contraire, pressé par le temps, il allait à l’essentiel : le principe de vie et celui de mort, l’entropie, cette force d’usure de l’univers, à l’œuvre depuis les origines, aux prises avec la prolifération du vivant. Combinant le mécanique avec le biologique il a fouillé le monde animal, observé ses éléments dispersés, comme pour mieux voir à l’œuvre les principes d’amour et de haine qui, selon Empédocle, reconstitue les créatures. Il y a découvert et isolé un élément essentiel, celui qui commande au mouvement : la rotule. Associant le jeu à la cruauté, il va ensuite décliner cet élément sous toutes ses formes dans ses dessins, ses travaux sur toile et sur cuivre, en constructions gigantesques, donnant naissance à des chimères, anticipant des mutations, s’efforçant d’imaginer ce que la nature n’avait pas encore osé... Depuis sa disparition prématurée, en 1971, à l’age de trente ans, ses toiles et ses gravures demeurent l’exemple d’un travail «aux limites»: une précision du dessin, une maîtrise de la ligne et de la couleur qui nous initient à des tentations monstrueuses et exquises de l’esprit. Sans doute François Lunven prévoyait-il rapproche d’une société virtuelle, et nous livrait-il à reffroi et à la fascination que suscitait en lui cette appréhension.
Jean - Pierre Velly,
à la recherche désespérée
d’une unité perdue
Quant à Jean-Pierre Velly, s’il admirait le travail de Lunven, il admirait encore plus cette écrasante beauté qu’il découvrit dans les musées italiens au cours de son séjour à la Villa Médicis de 1967 à 1970. Cette beauté n’entravait nullement sa création. Au contraire, elle la nourrissait, elle amplifiait ses visions de « vanités », ses pressentiments d’un monde menacé où des grappes de corps humains participent à une sorte de symphonie «panique» qui pourrait être une danse macabre au bord d’un gouffre. Ses gravures convoquent les monstres, brassent les corps, remuent notre mémoire. C’est le pathos de l’histoire de l’art, la «mémoire involontaire» dont parle Walter Benjamin, qui dénie devant nos yeux dans une audacieuse relecture du passé, avec cette tentation jubilatoire de mettre en scène une chair parfois glorieuse, souvent malmenée, et de réussir enfin son association avec la splendeur d’un paysage romantique. Pour Velly, les formes n’existent qu’impures, et l’on peut s’attendre à ce que sans cesse elles se transforment ou se rejoignent. De même Aby Warbourg, à la fin du XIXè siècle, avait compris que la fonction rituelle du Laocoon de la Grèce antique n’était pas essentiellement différente de celle du serpent chez les Indiens Hopi et que les formes avaient leur vie propre, indépendante des catégories esthétiques de l’histoire de l’art officielle. Cette lutte à contre-courant, cette recherche désespérée d’une unité perdue, Jean-Pierre Velly, lui aussi, par sa gravure, s’est attaché à les poursuivre.
Dans les années soixante-dix, la peinture, qui n’en finissait pas de s’interroger sur elle-même, me paraissait épuisée. C’est à cette époque que je trouvais chez Velly ce que j’attendais précisément du travail artistique : un maniérisme subversif et un anachronisme, pour le plaisir de l’œil. Nul ne réussissait mieux que lui à maintenir la gravure dans une ivresse visionnaire, pour convoquer et fouiller jour après jour sur le cuivre les figures pathétiques qui nous hantent depuis nos origines, ces propositions glorieuses, inquiètes ou déchues de la forme humaine qui sont parvenues jusqu’à nous depuis l’Antiquité, en passant par Dürer, Goya, et Bacon. C’est dans cette continuité, mais par un foisonnement obsessionnel nouveau et une sorte de somptuosité baroque, que Velly a traduit l’abjection humaine, la crainte d’un retour à la barbarie et le sentiment de menace apocalyptique qui hante notre époque (7).
Échapper à la relativité de l’art
Velly n’est plus là pour le confirmer, car il est mort en 1990, mais je suis certain qu’il m’aurait approuvé si je lui avais fait part de ma conviction qu’il existe un art intemporel, que l’on pourrait reconnaître dans la succession Duvet, Seghers, Redon, Bresdin, Bonnard, par exemple, un art plus «visionnaire», moins orthodoxe que celui retenu par l’histoire de l’art. C’est d’ailleurs avec cette conviction que j’avais entrepris mes premières gravures, dans les années soixante - dix. Comme Jean-Pierre Velly, j’entretenais cette idée folle qu’on pouvait échapper à la relativité de l’art, et se servir du tableau et de l’estampe comme un moyen d’approcher l’absolu, avec ce goût des suprêmes interrogations et des expiations qui reviennent régulièrement dans notre histoire: la finitude, la barbarie, mais aussi l’utopie et le merveilleux. Les titres de mes gravures le confirment : La Nostalgie de l’unité ; Mémoire géologique; Ange; La Petite Peur, cette entreprise était un combat désespéré pour reconquérir l’unité perdue et retrouver cette présence lumineuse qui me touchait tant dans les gravures des maîtres anciens, ce témoignage de l’indicible, que j’interprétais comme le souvenir d’une filiation lointaine entre l’art et le sacré, la force de l’image et du désir de voir qui nous saisit quand la divinité se refuse au regard, selon la pensée de Grégoire de Nysse au IVème siècle (8).
Le cuivre a de puissants pouvoirs pour libérer l’imaginaire
On l’a vu, si les artistes visionnaires pratiquent souvent la gravure, ce n’est pas un hasard. Le cuivre a de puissants pouvoirs pour libérer l’imaginaire. Nous gardons tous en mémoire la ciselure savante et rigoureuse de l’Adam et Eve et du Chevalier à la mort de Dürer, la froide cruauté des eaux-fortes de Goya dans Les Désastres de la guerre et l’univers foisonnant que Bresdin fait tenir dans les quelques centimètres carrés de ses paysages imaginaires. Le cuivre contient en puissance un monde riche de surprises et d’hallucinations que le geste du graveur s’applique à retenir. Cette alliance inespérée du fugitif avec la permanence, avec la densité de la matière, c’est la fascination du graveur devant le cuivre. Au métal poli et miroitant, sensible au moindre souffle, il peut confier ses fantasmes, mais la confidence ne peut se faire que dans la violence, car si le moindre reflet nuancé d’une chair palpitante peut être gravé, c’est par la brûlure de l’acide ou l’action d’un outil acéré, la pointe-sèche. «Tant de violence dans l’amour, tant d’amour dans la violence : telle est la loi des naissances que l’homme de la gravure reconnaît en lui- même » (9). Cette pratique exigeante est source de remises en question et de déviations imprévues, mais ce sont autant d’accidents et de catastrophes qui relancent et enrichissent sans arrêt la vision du graveur (10).
L’« art visionnaire » est
à la recherche de cet accord
perdu avec la Nature
et ses lointains prodiges
Nous baignons aujourd’hui dans une iconographie permanente qui provoque un élargissement de la pratique artistique. On semble évoluer vers un art de masse dont parfois la qualité en dit long sur l’investissement de leurs auteurs. La marginalité esthétique et les pratiques atypiques, la valorisation du singulier en régime démocratique et de sa logique transgressive sont un bon révélateur de notre société et de sa culture (11). Dans ce contexte, l’«art visionnaire», lui aussi pourtant singulier ou atypique, n’est pas assez «transgressif» pour être légitimé par les pouvoirs publics, ce qui pourrait bien signifier qu’il est transgressif par son authenticité et son absence de volonté d’intégration. A une époque où les hommes cherchent par tous les moyens à combler un vide spirituel, ce que l’on présente comme «art visionnaire» reste cependant dangereusement menacé d’amalgames et trop souvent encombré d’irrationnel. L’« art visionnaire» n’a pas le monopole de la vision ; on pourrait dire que souvent même il s’y oppose, tant il est nourrit d’extravagances. Il n’est pas toujours facile de distinguer entre les dingueries gratuites et les productions les plus inspirées, héritières de celles des grands visionnaires du passé. On l’a déjà vu, les œuvres les plus exigeantes sont toutes restées fidèles au «beau métier». De plus, leurs auteurs se sont nourris de l’art baroque et maniériste ainsi que des peintures de Max Ernst, Dalì et De Chirico. Les querelles esthétiques laissent indifférents leurs créateurs, car ils se préoccupent peu d’histoire de l’art. Cette réserve leur donne d’ailleurs plus de liberté pour traiter de questions intemporelles, ce qu’ils affectionnent particulièrement. Ils sont à l’aise pour dénoncer la vanité des choses humaines devant les forces naturelles, ou critiquer la techno-science et son pouvoir de gouverner notre désir à l’infini. Leur obsession d’un ailleurs les conduit à la démesure : ils éprouvent le besoin d’inventer des mondes fabuleux, des totalités vivantes et sublimes, des mises en scène improbables de créatures désincarnées. On pourrait leur reprocher d’agiter des peurs ancestrales tant leur entreprise donne le vertige, car ils tentent des synthèses, pressentent et anticipent des catastrophes eschatologiques. Mais lorsqu’ils s’abandonnent à leurs tâches utopiques, à leurs délires, à leurs fictions audacieuses, c’est pour retrouver un état de grâce ou bien pour conjurer une angoisse séculaire. Leur travail se situe alors entre «faire et défaire», dans l’accomplissement d’une image où le temps ne compte plus.
La réalisation d’un tableau «visionnaire» reste pour moi la lente élaboration d’une présence inquiète, faite de tragique et de merveilleux, dont l’aboutissement est à la fois une utopie enfin réalisée et un délicieux piège a regard. Plutôt que d’ordre esthétique - le « visionnaire » flirtent avec la beauté classique mais revendiquent volontiers l’ anachronisme - ce sont des préoccupations d’ordre philosophique, ésotérique ou prémonitoire qui inspirent ces artistes. Ils aiment fréquenter le «prodigieux», le surnaturel, et ils sont sensibles aux obsessions et aux appréhensions récurrentes qui accompagnent notre histoire. Comme l’explique Georges Bataille (12), depuis que l’homme, en devenant sédentaire, a perdu le contact avec les éléments et les phénomènes naturels, tout se passe comme s’il s’était séparé des Dieux. Il en reste inconsolable, et seules les œuvres d’art, héritières des objets votifs des premières sépultures, peuvent lui rappeler l’accord perdu avec la Nature et ses lointains prodiges, et ainsi le réconcilier avec le sacré. L’«art visionnaire» est à la recherche de cet accord perdu, et si les questions que posent cette peinture et celle gravure restent fécondes et prennent à nouveau sens aujourd’hui, c’est sans doute parce qu’elles sont l’expression d’une conscience critique et tendue, et d’un ardent désir de voir, partagés entre une grande nostalgie des origines et une grande peur du XXIè siècle.
1.Expression empruntée à Gilles Deleuze.
2.Il s’agit de Jacques Moreau, dit Le Maréchal.
3.Le Maréchal, catalogue de l’oeuvre gravé, O.G.C. Michèle Broutta, Paris, 1985 p.11
4.Idid. p.9
5.Ibid. p. 14
6.Ibid. p.7
7.Jean-Pierre Velly, graveur, Yves Doaré, texte inédit, 2002
8.« Yves Doaré » monographie, Editions Palantines, 2004 (Le corps impossible, entretien avec Georges Rubel)
9.Claude Louis-Combet : « Prémisses de la nuit », préface du catalogue Stratégie de l’ombre, Douarnenez, 1980
10.Graver, Yves Doaré, texte inédit, 1982
11.Voir à ce propos l’étude de Nathalie Heinich : L’Elite artiste, excellence et singularité en régime démocratique, NRF 2005
12.Préface de Lascaux ou la naissance de l’art, éditions Skira, 1955