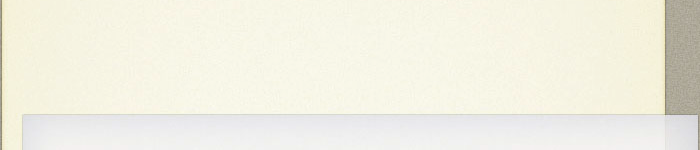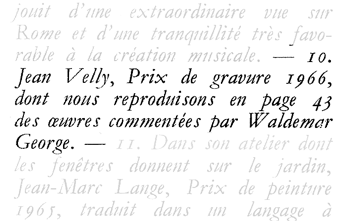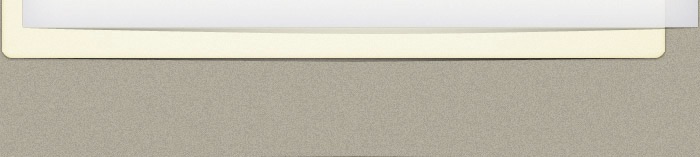Vous êtes à Rome. Vous venez de gravir l’escalier de la Trinité des Monts écrasé de soleil, en enjambant des beatniks hirsutes et alanguis et en passant dans le champ des appareils photographiques braqués sur des jeunes filles aux attitudes figées ou sur des couples de cartes postales. Peut-être, si vous venez de la Via Veneto, avez-vous longé les remparts et, au détour d’une rue, avez-vous aperçu un jeune homme assis sur le trottoir près d’une Vespa, une toile sur les genoux et un pinceau à la main, peignant d’après nature une statue qui émerge d’un jardin. Vous n’avez nullement imaginé que ce peintre du dimanche était un Prix de Rome 1965 de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Vous n’avez pas pensé non plus, en le longeant, que ce mur qui sépare la ville bruyante et embouteillée de la verdure du Pincio était une frontière entre l’Italie et la France, et qu’il cache les pensionnaires de la Villa Médicis dont vous allez admirer les décors rénovés par Balthus, directeur de l’Académie de France.
Les pensionnaires sont, ici ou là, tantôt chez eux, seuls ou avec leurs femmes, tantôt dans leurs ateliers parfois très éloignés de leurs logements; plusieurs sont absents, soit qu’ils voyagent, soit qu’ils se trouvent en ville en train de fondre une sculpture de bronze ou de fouiner au marché aux puces de la Porta Portese. L’Académie de France à Rome n’a rien d’un collège, ni d’un monastère. Cette première impression de liberté totale vous sera d’ailleurs confirmée par les lauréats eux-mêmes, qu’il s’agisse de leur mode de vie ou de leur travail.
« Nous voyageons tout le temps, nous partons quand nous voulons, le temps que nous voulons », vous dira avec enthousiasme Gérard Barthélemy, Prix de Rome de peinture 1966, qui habite avec sa très jeune femme dans une petite maison avec jardin. Ce qui lui permet de découvrir l’Italie et l’art italien.
Fière d’avoir obtenu à la fois 1er Prix de Rome de composition musicale 1964 et un Premier Prix au Conservatoire, ce qui est un cas unique, Thérèse Brenet vit au contraire en recluse, obsédée jour et nuit par la recherche d’une idée musicale ou la traduction d’un texte qui exige une tension intérieure épuisante.
« Je fais tout ce que j’ai envie de faire, tout ce qui me passe par la tête », vous diront aussi bien Denis Mondineu que Louis Lutz. Prix de médaille 1966, le premier se sent d’abord sculpteur et achève entre deux effigies une femme plantureuse, plus haute que lui, qu’il à taillée dans un bloc de bois trouvé par hasard dans le parc. Prix de sculpture 1964, le second se livre entre deux bronzes à son vice favori : le modelage de « petites bonnes femmes », avant de s’attaquer au polystyrène.
Quant à l’autre sculpteur, Jacqueline Deyme, qui en est à la fin de son séjour romain et dont l’atelier se trouve juste en dessous de la cellule sonore de Thérèse Brenet, elle délaisse ses sculptures polychromes pour composer en plastique et en tuyaux de caoutchouc la maquette d’un square pour enfants, qui lui a été commandé.
Cette liberté qui permet de passer d’une chose à une autre, la vie à Paris la leur interdisait. Ici ils « ont le temps », rien ne les presse et cette trêve de trois ans leur permet avant tout de chercher et de suivre leur propre voie, fut-elle encore sinueuse et incertaine.
« C’est en oubliant ce que font les autres, ce qu’il faut faire et ne pas faire que j’ai trouvé ici ma personnalité » vous dira le sculpteur Lutz, qui en est à sa dernière année. « Ce temps passé ici, à l’abri des soucis matériels et financiers, m’aura permis de poursuivre et de faire des recherches que je n’aurais jamais pu réaliser autrement », vous dira Bernard Schoebel, Prix de Rome d’architecture 1964. Ses recherches? Celles d’un urbanisme humain dans lequel la nature prendrait une grande place, certes; mais sa pensée profonde, devant l’angoissante course folle de notre monde, est d’installer l’homme au fond des océans « sans espoir de retour à la surface ».
A Rome, l’oeuvre de Jean-Marc Lange, Prix de peinture 1965, a pris un nouveau tournant : plus personnel. Seul avec lui-même, il se cherche encore et s’engage à la fois dans plusieurs directions; mais alors que, durant trois ans passés à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen et seulement trois mois aux Beaux-Arts de Paris, il se laissait directement inspirer par la nature et peignait des paysages, il se livre à Rome à un travail plus intérieur. Frappé d’abord par « tout ce qui bouge, vit, grouille (plages, beatniks, et « capelloni »), il «repense » les thèmes de son inspiration et se crée peu à peu un univers imaginaire.
La démarche introspective de Jean-Marc Lange vous amène à lui poser, avant les autres, cette question : « Et si vous n’étiez pas à Rome ? Si vous bénéficiiez des mêmes conditions de vie et de travail en tout autre lieu qui ne soit pas Paris? » Réponse : « Les effets seraient probablement les mêmes. » Bien qu’il rencontre souvent des peintres italiens et qu’il ait à Rome de nombreux contacts sur le plan artistique, J,-M. Lange ne pensait pas que Rome exerce une influence sur son œuvre en tant que ville-musée. En revanche, il avoue être influencé par la vie romaine, celle de la rue, des places publiques, de tous les centres d’affluence. « L’art et la vie s’y mêlent, ne font qu’un, dit-il. Tout y est peinture. » Très satisfaite de ses trois années romaine, Jacqueline Deyme partage cette opinion. Elle aime Rome et parle avec enthousiasme de cette « ville si vivante », et qui ne l’empêche pas d’être également « fascinée par la sculpture baroque », particulièrement par le Bernin, aussi bien d’ailleurs que par la sculpture antique et classique. En ce domaine elle s’oppose totalement au Prix de sculpture de l’année suivante, Louis Lutz, qui n’hésite pas à déclarer : « Je n’aime pas Rome. La sculpture romaine, de l’Antiquité au Bernin, ne vaut rien, à part le Marc-Aurèle du Capitole. Etre à Rome ou ailleurs ? Ce qui compte, c’est de ne pas être à Paris, ou l’on a tendance à céder aux tendances et aux impératifs de l’époque, où il faut faire du non-figuratif à tout prix, ou l’on conçoit la sculpture comme un défoulement, au lieu d’apprendre son métier, de penser ce que l’on crée, de faire des choses qui aient un sens. »
S’il reconnaît l’enrichissement constant que lui a procuré une ville « où la noblesse est innée et où l’on découvre chaque jour quelque chose de plus beau», Bernard Schoebel ne doit rien à Rome sur le plan architectural : « le temps des relèves est mort » et, selon lui, l’architecture moderne y est inexistante.
Pour la musicienne Thérèse Brenet, seule compte la rupture avec Paris, c’est-à-dire la rupture avec tout. Quand on entre au couvent, qu’importe ou il se trouve ! Pourtant, elle regrette que l’on ne parle pas d’elle davantage, d’autant plus qu’elle s’est déjà fait connaître à Paris. L’ORTF lui a proposé cinq minutes en la laissant absolument libre. Libre comme elle l’est ici, à l’Académie de France, de refuser l’académisme, qu’il soit classique ou sériel, pour se laisser emporter par la violence de son inspiration qui l’incite à écrire des partitions non chantées mais « hurlées». « Par rapport aux autres pensionnaires musiciens et au style de l’établissement, dit-elle, je suis une révolutionnaire. »
On se demande néanmoins si actuellement le plus révolutionnaire des pensionnaires de la Villa Médicis ne serait pas plutôt le jeune peintre Barthélemy déjà cité. Lui respire l’air de Rome, s’imprègne de l’atmosphère romaine et trouve autour de lui ses sources d’inspiration, de préférence sa femme, mais aussi les sites où domine la végétation, tels ceux de la Villa Médicis même : « Je vis dans le vert », vous dira-t-il, un pinceau à la main imbibé d’aquarelle verte, prêt à vous badigeonner d’espérance.
Alors que ses camarades pensent, se concentrent sur eux-mêmes, se cherchent, se défoulent, échafaudent leur univers intérieur, sécrètent douloureusement les fils d’un thème fugace, édifient des villes sous-marines où se mettent dans la peau des enfants de Massy-Palaiseau, ce jeune original est à peu près le seul à nous rappeler que l’Académie de France n’était pas seulement destinée à l’origine à procurer aux élèves sortant des Beaux-Arts le calme d’une retraite qui leur permette de faire le point et de découvrir leur vraie personnalité. Partisan d’un retour à la nature et à l’objet, refusant de se poser trop de questions, osant accuser Cézanne et nier l’apport du cubisme, il se promène avec son carton à dessin, sensible à ce qu’il découvre au coin d’une rue ou au détour d’une allée: il peint ce qu’il voit.
Gilles Quéant